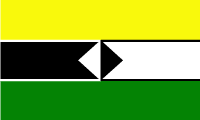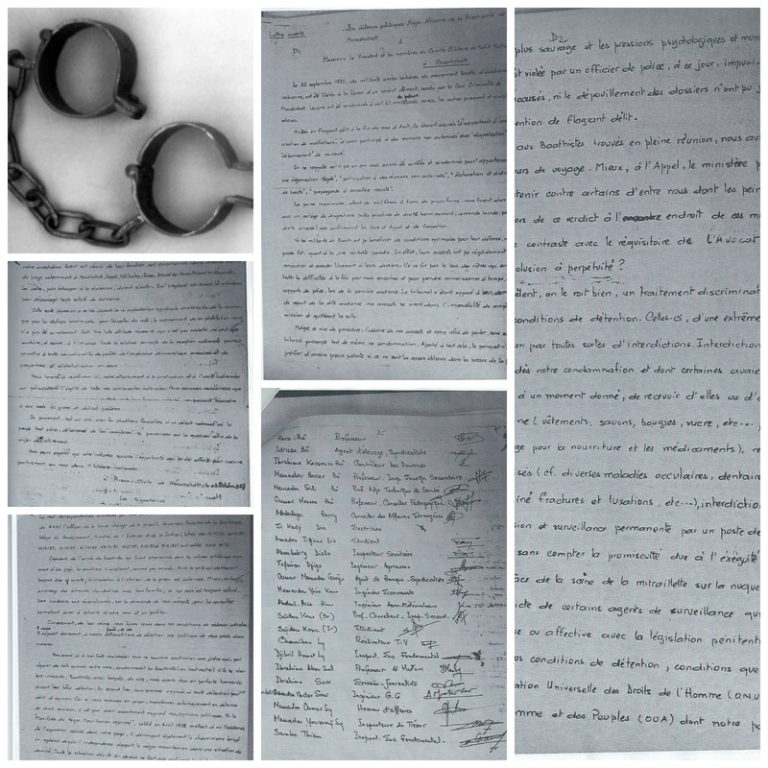Il avait le visage sombre, sans expression, sans vie, peut-être à cause de ses yeux presque éteints. Un instant seulement il s´est animé, en sortant une liasse de papiers de sa serviette, qu´il m´a tendue. Il y en avait des pages et des pages photocopiées, où s´alignaient des noms, des grades, des lieux, des dates…
– Tous ceux-là sont morts, m´a-t-il dit d´une voix sourde. Regardez bien, lisez.
Ensuite, il a raconté son histoire:
Je suis un militaire de carrière, brigadier-chef de la Garde Nationale, ancien commandant de brigade de T., une ville qui se trouve non loin de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. J´ai derrière moi vingt-quatre ans de service militaire.
Aussi loin que je remonte dans ma vie, depuis que j´ai commencé à comprendre, j´ai toujours constaté que les noirs n´avaient aucun droit, et que les Maures blancs étaient privilégiés. Chez nous, sur vingt ministres au gouvernement il y a un quart seulement pour les noirs, à l´armée, un seul Noir pour dix officiers. Dans un stage, si un Maure a mal travaillé, il l´emporte portant sur n´importe quel Noir. Et pas question de protester.
Moi, je me suis accommodé de cette situation injuste, sans jamais faire de politique. Il me fallait vivre, et ma famille aussi. J´ai sept enfants, ou plutôt huit, le dernier, je ne l´ai encore jamais vu, il est né après mon exil.
C´est le 25 novembre 1990, que tout a commencé, par la réception d´une lettre de mon supérieur hiérarchique de la région militaire T., dont dépend ma brigade. Ce dernier me demandait de passer immédiatement mon commandement à mon adjoint, de me rendre à R.. Toutes affaires cessantes. Dès le message reçu, j´ai obéi, et j´ai pris un taxi pour R. muni de mon paquetage. Je suis arrivé vers midi à la caserne, et me suis présenté au bureau du chef, le capitaine A. Son secrétaire m´a dit de l´attendre.
A quinze heures, le capitaine est apparu, il m´a appelé, et m´a seulement annoncé que je commanderai la section qui allait hisser le drapeau chez le gouverneur, trois jours plus tard, le vingt-huit novembre, date anniversaire de l´indépendance de la Mauritanie. En attendant, j´habiterai la caserne et je devrai assister aux quatre rassemblements de la troupe, qui avaient lieu tous les jours. Le 28 novembre, comme prévu, j´ai participé à la fête de l´indépendance. Nous avons reçu pour l´occasion des uniformes neufs. Le gouverneur a fait son discours, le drapeau a été hissé, et je suis revenu à la caserne à la tête de la section.
Je croyais après cela que j´allais repartir pour T. retrouver mes hommes, mais on m´a donné l´ordre de rester à R et de continuer à assister aux quatre rassemblements quotidiens: le premier à huit heures du matin, rassemblement général des troupes, élèves compris, et lever des couleurs, à midi, rassemblement pour les corvées des soldats, ordres, missions, à quinze heures, rassemblements de contrôle, et à dix-huit heures, le dernier rassemblement pour la descente du drapeau.
J´ai vécu ainsi pendant près d´un mois. A la radio, on parlait de la guerre du Golfe et d´évènements graves à Nouadhibou, la capitale économique du pays. Confusément, je m´attendais à quelque chose.
Enfin, le 20 décembre, mon capitaine m´a fait savoir que j´étais dispensé des rassemblements du jour à la caserne, et que je devais me tenir à sa disposition.
A quinze heures, un planton est venu me chercher, c´était urgent, je le suivis.
En passant dans la cour, nous avons croisé le capitaine, nous nous sommes salués. Le capitaine m´a informé de mon retour à T.. Il fallait me préparer et le rejoindre ensuite. Je suis donc retourné dans ma chambre, j´ai rassemblé mes affaires, je les ai portées dans la Land-Rover qui devait m´amener. Ensuite je me suis dirigé vers le bureau du capitaine, en treillis, rangers aux pieds. Dans la salle d´attente, le secrétaire est venu s´asseoir à côté de moi.
Et puis soudain, la salle a été envahie par quatorze gardes, tous des blancs, trois d´entre eux portaient des fusils, les autres des menottes et des chaînes.
Leur chef m´a crié qu´ils avaient l´ordre de s´emparer de moi et de m´attacher. J´étais révolté, j´ai demandé ce que j´avais fait? Ils ont répondu qu´ils n´en savaient rien, et que ce n´était pas leur problème.
J´ai donc été ligoté une première fois. A ce moment, le capitaine est entré, son pistolet à la main. Il a ordonné qu´on m´attache plus fortement encore.
La colère m´a pris, on m´avait jamais traité ainsi, en plus de vingt ans de service, pas une punition ne m´avait été infligée. J´ai profité de l´instant où mes bras ont été libres pour réagir, me défendre. Je ne voulais pas qu´on m´attache, mais qu´on m´explique ce qui se passait d´abord!
On m´a frappé à coups de crosse, à coups de chaînes en fer. Avant de tomber à terre, j´ai aussi frappé le chef des gardes, je n´avais peur, ni de lui, j´étais de taille à l´affronter, ni des fusils avec lesquels on me menaçait, je savais qu´ils n´avaient pas de cartouches…
Ils ont du s´y mettre à plusieurs reprises pour me maitriser et me lier comme le chef le voulait: deux menottes aux poignets, les bras dans le dos, deux menottes aux chevilles, et enfin des menottes pour relier les mains et les pieds. Cela s´appelle « le jaguar », car c´est dans cette position qu´on accroche cet animal sur une perche, après la chasse. Les menottes possédaient des dents acérées à l´intérieur, elles m´entraient dans la peau, j´en porte encore la marque aujourd´hui.
Je suis resté sur place dans cette position jusqu´à environ huit heures du soir. Ensuite les gardes ont apporté un sac de riz vide, un grand sac, qui peut contenir cent kilos, ils m´ont mis à l´intérieur, et m´ont transporté jusqu´à la Land Rover dans la cour. Ils m´ont jeté au fond de la voiture, et ils se sont assis sur mon corps.
La voiture a démarré, nous sommes sortis de la ville. A environ 70 kilomètres de R.. se trouve un terrain nu, c´est le Centre de tir. Là, on m´a fait descendre, on m´a jeté sur le sol, et les gardes se sont mis à préparer du thé.
A un moment donné, ils m´ont déchiré ma tenue militaire à l´aide d´un couteau. Je suis resté en slip dans le froid et la nuit. La région est réputée pour ses moustiques, ces derniers s´en sont donnés à cœur joie.
Le capitaine est arrivé à environ 23 heures. Il a ordonné aux gardes de creuser un trou dans le sable. Lorsque le trou a été creusé, il a sorti son pistolet et s´est posé juste devant moi pour m´annoncer que le gouvernement avait appris qu´un coup d´état des FLAM était en préparation contre lui dans la ville de Nouadhibou. Je devais être au courant, il fallait que je dise ce que je savais là-dessus. Sinon, ma tombe était prête et j´allais mourir. En revanche, si je parlais, on me détacherait, on me rhabillerait, et on me ramènerait à la caserne comme si de rien n´était.
J´ai répondu que je ne savais rien du complot, et que je n´avais pas mis les pieds à Nouadhibou depuis six mois. Avant de venir à T. j´étais en garnison seulement à Kiffa et à Nouakchott. «
-Tu ne veux pas parler, tant pis pour toi », a dit le capitaine.
A partir de ce moment-là, il a changé de ton pour me parler, les gardes aussi. Ils ont utilisé des mots dégradants humiliants, ils crachaient sur moi, m´appelaient: « Sale nègre ». Après, ils n´ont plus cessé.
Le capitaine a demandé aux hommes le tabac en poudre qu´ils utilisaient pour leurs pipes. Beaucoup fument la pipe chez nous. Chacun a sorti ses réserves, et en a vidé une part sur un morceau de turban. Ils ont mélangé du piment moulu avec le tabac, dans un pot de thé.
Une nouvelle fois, le chef m´a demandé si je voulais parler, j´ai répété que je ne savais rien.
On m´a allongé sur le dos, et on m´a mis, en guise de bandeau sur les yeux, le morceau de turban et son mélange de piment et de tabac en poudre. J´ai eu beau essayer de fermer les paupières, la mixture s´est infiltrée et a commencé à brûler d´une façon atroce. Un quart d´heure plus tard, le capitaine m´a interrogé à nouveau, et on m´a remis du mélange sous le bandeau. Les gardes ont recommencé à trois reprises. En même temps les hommes ont amené un réservoir d´eau de la voiture et m´ont arrosé. Notre climat désertique fait que les nuits sont très fraiches, par opposition au jour. Et les moustiques n´arrêtaient pas de piquer par-dessus le marché.
J´avais froid et surtout très mal, mais je supportais la douleur. De toute façon, je n´avais rien à dire. A la fin, on m´a remis dans le sac de riz vide, transporté dans la Land Rover, et ramené en ville. Je ne pensais plus à rien, j´étais sûr qu´on allait me tuer maintenant. Un autre trou dans le sable comme tombeau.
On m´a enfermé dans un local de la caserne, un local sans toit où le vent pénétrait. J´étais étendu sur le sol de ciment, et j´ai entendu qu´on plaçait une sentinelle devant la porte, avec son fusil.
Je suis resté là jusqu´au lendemain, toujours attaché et le bandeau plein de tabac sur les yeux. Le capitaine est revenu à midi avec des gardes. Une nouvelle fois il a sorti son pistolet, m´a fait sentir son canon sur la tête, et m´a demandé si mon choix était fait, si je préférais parler ou mourir ? Une nouvelle fois, moi aussi, j´ai répété que je ne savais rien, et que je ne voulais pas mentir.
– » On attendra », dit le capitaine à ses hommes.
Je suis resté deux jours dans le même local, attaché, le bandeau sur les yeux, sans boire ni manger. Les sentinelles se relayaient toutes les deux heures. En prenant leur tour de garde, elles appliquaient les instructions reçues, me frappaient à coups de pied et m´arrosaient d´eau froide. Cinq fois de suite elles me remirent dans les yeux du tabac chauffé avec du thé.
Je m´affaiblissais, je souffrais, je pensais toujours à la mort, j´étais convaincu que j´allais mourir, d´ailleurs, il me semblait préférable de mourir plutôt que de subir encore la situation dans laquelle je me trouvais. J´avais accepté mon sort, j´avais déjà un pied dans l´au-delà.. Dans un local voisin, j´entendais des gémissements et des plaintes sourdes. C´était la voix du chauffeur du capitaine, un Noir comme moi, qu´on torturait. Le troisième jour, le capitaine est venu, accompagné du commandant du centre. Ils appartenaient à la même tribu de Maures, mais le commandant était un homme intègre.
Il a interrogé le capitaine et les gardes, qui lui ont raconté comment ils m´avaient traité pour me faire parler, les piments et le tabac mêlés au thé dans les yeux, les menottes, l´eau froide sur le corps, les coups, le manque de nourriture et de boisson.
Le commandant leur a dit: »-puisqu´il n´a pas parlé avec tout ça, c´est peut-être qu´il ne sait rien. Qu´on le libère ».
Le commandant est parti, mais je n´ai pas été libéré. J´ai appris plus tard que l´officier avait envoyé un rapport à l´État-major à mon sujet. A la suite de quoi, il a été convoqué à Nouakchott, où on lui a reproché d´avoir demandé ma libération. Il eut l´ordre d´arrêter tous les Négro-africains de la garnison de R .mais il a refusé, disant qu´il était prêt à tout, mais pas à arrêter des innocents.
Moi, on m´a donné pour la première fois depuis mon arrestation un peu de bouillie tiède à manger. J´ai vomi. La même nuit on m´a transporté à T.. D´où je venais, et on m´a enfermé dans une prison dont j´ignorais même l´existence, de nouveaux bâtiments destinés à un tout autre usage. Dès mon arrivée, on a commencé à me battre vraiment. Pas des coups occasionnels, comme durant les premiers jours de détention, mais des raclées systématiques, accompagnées de coups de baïonnettes, dont je garde encore des traces sur le corps. On m´a battu toute la nuit, des soldats que je connaissais, c´était trop, l´idée de la mort me poursuivait, seulement je ne pouvais pas mourir, la mort ne voulait pas de moi!
La prison a commencé à se remplir peu à peu les jours suivants. Nous nous sommes retrouvés à 70, tous des militaires Négro-africains, rassemblés dans une seule salle au sol cimenté, sans sanitaires, avec une porte en fer ornée d´un gros cadenas. Nous avions les yeux bandés en permanence, exceptés quatre ou cinq d´entre nous, pour une raison inconnue, peut-être par manque de turbans. Ceux-là nous racontaient tout ce qui se passait, si bien qu´à la fin, les gardiens les ont mis à part, en quarantaine, pour qu´ils ne nous parlent plus.
Tous les matins on nous sortait de nos cellules et on nous alignait dehors. Le capitaine arrivait, je le connaissais aussi, il faisait une croix à la craie devant ceux qu´on allait torturer ce jour-là. L´angoisse nous avait déjà serré le cœur, bien à l´avance.
Les tortures étaient pratiquées de différentes façons. Par exemple, on creusait des trous dans le sable, on nous enterrait jusqu´au coup, la tête immobilisée, le visage nu tourné vers le soleil. Si on essayait de fermer les yeux, les gardes nous y jetaient du sable. Ensuite on nous remettait nos bandeaux.
D´autres prisonniers étaient emmenés jusqu´à un puits, qui ne contenait que peu d´eau. Ils étaient attachés par les pieds à fond. Ils suffoquaient, on les ressortait, et on recommençait.
Ces tortures n´étaient plus faites pour qu´on parle du complot, tout le monde savait maintenant que le coup d´état, soit disant en préparation, n´avait jamais existé. Les tortures étaient gratuites, elles avaient pour but de nous éliminer, nous les Noirs, les Maures du système savaient que même les rescapés seraient des gens diminués pour toujours. La guerre du Golfe servait de prétexte, la haine expliquait tout.
Cela dura vingt et un jours, jusqu´à l´arrivée d´un officier de renseignement de l´État-major.
Ce matin-là, on nous retira nos bandeaux, ainsi que les menottes entravant nos pieds. On nous garda que celles de mains, attachées dans le dos. Les gardes nous firent sortir, cinq par cinq, en dehors de la prison. L´officier n´en avait pas franchi la porte, il se tenait assis derrière une table, et prenait des notes, le capitaine assis á ses côtés.
Certains d´entre nous ne pouvaient plus tenir debout. Ceux-là ont été traînés, ou même transportés.
Lorsque ce fut mon tour de passer devant lui, l´officier se mit debout, s´avança vers moi.
J´étais sale, comme les autres et abîmé de partout. Il me souleva la tête, me demanda si je le reconnaissais. J´y voyais très mal, mais j´ai dit oui. Nous nous connaissions depuis des années, il savait ma conduite toujours exemplaire. «pourquoi lui a-t-on fait ça ? » a -t-il demandé en voyant sur moi les traces de tortures.
Il a ordonné au chef d´enlever tout de suite le tabac qui restait dans mes yeux, et demande qu´on fasse venir un médecin. Le capitaine a répondu qu´il était d´accord. On m´a mis de côté, et l´officier s´est occupé des autres prisonniers. Je ne l´ai pas revu avant son départ pour Nouakchott.
Un médecin est venu, il m´a examiné, m´a fait une ordonnance pour des médicaments. Lorsqu´il est parti, le capitaine a déchiré l´ordonnance et m´a jeté les morceaux de papier au visage.
J´ai déjà dit qu´au début nous étions environ 70 en prison. A la fin, il n´en restait que 16. Les autres étaient « partis ». Quand un prisonnier ne pouvait plus tenir, il disparaissait. Nous demandions où il se trouvait, on nous répondait: « – A l´hôpital ».
Mais en vérité, il avait été exécuté en cachette. Nous avons su tout cela seulement à notre sortie. Avant, nous l´ignorions, même si nous avions des doutes.
Nous, les survivants, nous nous trouvions aussi en bien mauvais état. Moi, je n´y voyais plus du tout, les camarades dirigeaient mes moindres gestes. Après la visite de l´officier, les tortures cessèrent pourtant.
Une délégation officielle est arrivée de la capitale, le 6 mars 1991 pour nous libérer. D´autres prisonniers l´avaient déjà été dans d´autres camps, dans d´autres prisons. Notre chef, lui, n´avait pas voulu nous rendre notre liberté, il avait écrit à l´État-major que nous étions trop visiblement abîmés pour nous relâcher.
Donc, la délégation est venue. On nous a rassemblé, certains tenaient sur leurs jambes, d´autres étaient par terre. Le responsable de la délégation s´est adressé à nous, nous a déclaré qu´il parlait au nom du président de la République et du chef du gouvernement , le colonel Maouya Ould Sid´Ahmed Taya. Il nous adressait ses salutations. Si nous étions emprisonnés, c´est que des soupçons avaient pesé sur nous:
– » Entre militaires, vous le savez, nous avons l´habitude de punir ceux qui trahissent et complotent. Nos soupçons n´étaient pas fondés, nous le reconnaissons. Le président s´excuse. Demain, on vous amènera des vêtements neufs et vous serez libres. N´oubliez pas que vous êtes des Mauritaniens comme les autres. Ne parlez pas de ce qui vous est arrivé. »
Ensuite le responsable a dit aux gardes de nous donner à manger. Ceux-ci se sont regardés, et l´un d´entre eux a levé la main pour demander la parole. Il a demandé si nous, les militaires torturés, nous allions rester en service dans l´armée, comme auparavant ?
Le chef a répondu affirmativement.
Le garde a repris alors:
» – S´ils sont maintenant dans l´armée, comme il y en a de plus gradés que nous, nous risquons d´avoir des ennuis avec eux ».
Cette remarque a du paraître justifiée, puisque nos tortionnaires ont été affectés dans une garnison au nord-est du pays, très loin de T.et de R. Le lendemain, on m´a conduit à l´hôpital de R. j´avais mal aux jambes, je pouvais à peine marcher, je n´arrivais plus à me servir de mes mains pour manger. Et je ne parle pas de mes yeux. Même me sachant libre, en théorie, je pensais toujours à la mort.
Des gardes nous surveillaient pour empêcher les visites. La nouvelle de notre libération s´était répandue, d´autres prisonniers d´autres camps étaient déjà rentrés chez eux grâce à des congés octroyés par l´armée. Beaucoup sont morts à ce moment-là, peut-être à cause du rétablissement trop brutal d´une alimentation normale.
Toujours à l´hôpital, j´ai appris que le président de la République nous avait accordé son « pardon » pour ce complot qui n´avait jamais existé. Il ne s´ agissait plus d´excuses comme on nous l´avait annoncé en prison!
Lorsque je fus quelque peu rétabli, on me transféra à l´infirmerie de l´État-major, à Nouakchott.
Je n´avais toujours pas de contacts avec quiconque, on ne voulait pas qu´on puisse me voir dans mon état. Des parents sont allés se plaindre au Ministère de l´intérieur, qui coiffe les unités de la garde. Ils ont demandé si j´étais toujours en prison ou alors en liberté? le ministre de l´intérieur a ordonné qu´on me laisse rencontrer ma famille.
Ma mère est arrivée de mon village, qui se trouve à 400 kilomètres de la capitale. Beaucoup auraient voulu l´accompagner, parents, amis, mais ils avaient peur, peur que les autorités puissent penser qu´ils venaient non seulement pour me voir, mais aussi pour témoigner dans une quelconque enquête qu´on aurait faite sur mon cas.
Ma femme et mes enfants n´ont pas quitté la maison, c´est peut-être tant mieux, car ils auraient souffert de me voir transformé comme j´étais, méconnaissable. Ma mère a pleuré lors de notre première rencontre, ensuite, elle m´a réconfortée. Elle a commencé à me prodiguer les soins traditionnels de chez nous, avec nos produits, elle me faisait des massages, elle passait des nuits entières à mon chevet..
J´ai subi aussi une opération aux yeux, pratiquée par un médecin français, mais il me fallait maintenant d´autres soins, nombre de médicaments coûteux, que ma famille ne pouvait payer. Mes parents demandèrent à voir mes supérieurs pour leur parler de ça, mais la demande fut bloquée au niveau du secrétariat de l´État-major.
Après des mois d´attente, j´ai décidé de rencontrer moi-même le chef d´Etat-major. Un matin, je suis allé l´attendre au parking où il garait sa voiture. Je l´abordai lorsqu´il arriva, et je lui expliquai le motif de ma demande, une demande d´audience qui traînait depuis quatre mois.
Le chef m´a bien regardé, il a réfléchi quelques minutes, et appelé son ordonnance. Je reçus l´argent nécessaire à l´achat de mes médicaments, et une voiture vint me chercher pour me ramener à l´hôpital.
Comme je lui avais parlé de ma famille, et dit que je n´avais pu rencontrer que ma mère, le chef donna aussi des ordres pour m´organiser un séjour au village. Une voiture avec un chauffeur fut mise à ma disposition, chargée de cadeaux pour les miens: cent kilos de riz, quarante litres d´huile, et une bonne somme d´argent.
Je fus heureux de me retrouver chez moi, de retrouver ma famille. J´ai appris qu´après mon arrestation, on avait renvoyé mes enfants de l´école. Parents et voisins pleuraient en me voyant, me faisaient fête, me prodiguaient des marques d´amitié.
Seulement, j´étais presque aveugle, et j´éprouvais sans cesse des malaises, en particulier, chaque fois que je mangeais, je me sentais diminué physiquement, je ne pouvais même plus « approcher » ma femme..
Après vingt jours passés au village, je suis allé au poste local de la garde et demandé de retourner à Nouakchott, pour revoir le médecin.
A l´État-major, j´ai rencontré le chef, de la même manière que la précédente. Il m´a aimablement demandé des nouvelles de mon congé, de ma famille, il m´a dit de continuer à me soigner. A ce propos, j´ai répondu que mon médecin voulait que j´aille en France pour qu´on m´y fasse une greffe de la cornée, qui me permettrait d´y voir à nouveau comme avant.
La demande de mon médecin est passée de l´État-major au ministère de la santé, puis à la direction du Budget. Là, on s´est exclamé: il n´était pas question d´opération en France, on avait déjà trop de dettes à l´égard de ce pays, et pas d´argent pour les payer. On m´a parlé d´Abidjan, en Côte d´Ivoire, ou alors du Maroc.
Les choses suivaient lentement leur cours, je perdais patience, lorsqu´une cousine me fit rencontrer une sœur de charité française. Sa visite eut lieu une nuit, car elle ne voulait pas se compromettre au grand jour en rencontrant des Noirs. La sueur a photocopié mes papiers, et les a emmenés en France lors d´un congé. Brusquement j´ai appris qu´une association acceptait de me prendre en charge, l´A.C.A.T (L´ASSOCIATION CATHOLIQUE D´AIDE AUX TORTURES). La nouvelle me rendit mon envie de vivre, j´allais enfin guérir, me retrouver comme avant. Le 29 février 1992, je pris l´avion, on m´avait confié à un médecin, mon grand frère m´attendait à l´aéroport, en France.
Quinze mois s´étaient écoulés depuis son arrestation, ses épreuves O.N. venait en France plein d´espoir pour obtenir réparation du passé, se faire opérer, retourner chez lui, recommencer à vivre. Son espoir ne fut pas exaucé.
Durant les six premiers mois, son état général s´améliora pourtant progressivement: On soigna son dos qui avait conservé des séquelles de coups reçus, il subit, l´une après l´autre, plusieurs opérations à ses yeux, mais il s´agissait seulement d´arranger les paupières abîmées dont les cils frottaient maintenant la cornée. L´œil droit voyait très mal, l´œil gauche était mort. Mais, contrairement aux prévisions antérieures, il s´avéra finalement qu´une greffe serait inopérante. Il fallut le lui dire.
O.N. se révolta, le spécialiste, n´y connaissait rien, on lui avait promis que …..
Un second médecin confirma le jugement du premier, O.N. en ressentit une immense déception, il eut la sensation d´une tromperie nouvelle, s´ajoutant à celle éprouvée en Mauritanie, où vingt-cinq ans de conduite exemplaire à l´armée n´avaient pas empêché l´injustice.
» – Je n´y voyais rien, je ne pouvais retourner à l´armée comme avant. »
Non, la vie ne recommencerait pas, la réalité réapparaissait, triste et sans perspectives: la malvoyance, toutes les autres séquelles des tortures endurées, l´éloignement du pays, la séparation d´avec sa famille, les souvenirs douloureux, les camarades morts.
Pour ajouter encore à un état devenu dépressif, O.N. apprit une terrible nouvelle, l´arrestation de son frère cadet, dans son village natal, à la suite du meurtre d´un maure. Ce dernier avait été victime d´un peul du Sénégal, avant de mourir, il avait dénoncé son assassin au commandant de brigade du village. Cela n´empêcha pas l´arrestation du frère de O.N. et de trois autres Noirs du village, ni leur mise à la torture pour avouer un crime qu´ils n´avaient pas commis. Quant au commandant, on l´affecta à un autre poste, à mille kilomètres de là: il avait rapporté la vérité au préfet du département, donc, contrarié le cours officiel de la justice..
« – J´avais toujours espéré revenir chez moi, je ne voulais pas me séparer de ma famille, de mes enfants, certains très jeunes. » O.N. ne savait que décider à présent, les nouvelles de Mauritanie n´étaient pas rassurantes, la répression anti-Noi reprenait de plus belle dans la vallée. S´il repartait, que lui arriverait-il ?
Il risquait la prison à nouveau, peut-être même la mort. Sa longue hésitation lui provoqua une autre maladie, le diabète, une hospitalisation urgente. Enfin, il y eut l´affaire du colonel Boïlil, tortionnaire et assassin de trois cents militaires Noirs, un des principaux responsables des évènements de fin 1990. Pour qu´il se fasse oublier, le gouvernement mauritanien l´avait fait admettre en stage à Paris, à l´école de guerre interarmes. Les autorités françaises l´expulsèrent, et le nom d’O.N.figurait à Nouakchott sur la liste de ceux qui étaient soupçonnés de l´avoir dénoncé.
– « Je n´étais même pas au courant de la présence du colonel en France », dit O.N.
Quoiqu´il en soit, sa famille le prévint: » Si tu rentres au pays, ils vont te prendre ».
Cette fois, la chose était claire, il ne pouvait plus repartir. Non sans une profonde amertume, O.N. demanda l´asile politique, qui lui fut aussitôt accordé, il entreprit les démarches nécessaires à la venue en France de sa femme et de ses enfants. Ce qui n´était pas simple: par exemple, lors de son arrestation, à T. Les militaires avaient recherché dans ses affaires des papiers éventuellement compromettants, et ils en avaient profité pour brûler ses papiers personnels, dont les originaux des actes de naissance de ses enfants.
Remis de son diabète, O.N., réagit portant, chercha du travail, et en trouva dans les cuisines d´un restaurant, pas pour longtemps, il n´y voyait pas assez clair: « – Je mélangeais les différentes sortes de fourchettes », raconte-il-, mi-figue, mi-raisin.
Il dut abandonner, la mort dans l´âme, sans plus vouloir rechercher d´autres activités.
Aujourd’hui´hui, il a terminé ses démarches administratives, son énergie est retombée, malgré les soins réguliers de son médecin. Il vit en province, chez son frère, au bord de la mer, il attend les siens en regardant longuement l´image trouble de ses enfants sur les photographies qui viennent du pays, où son frère cadet est toujours en prison, depuis 6 ans, sans jugement, accusé de meurtre sans preuve sinon « Noir ».
Il n´a rien d´autre à faire au long des jours qu´à ressasser son passé. La nuit, malgré les médicaments, les vieux cauchemars reviennent: il se trouve dans un cimetière, des gardes maures creusent sa tombe dans le sable, comme au champ de tir de R.ou dans la prison de T.il lui semble qu´il va mourir, au dernier moment, il s´éveille..
Son médecin écrit dans un rapport: » Bien que particulièrement lourd, le cas de monsieur O.N. n´en est pas moins exemplaire des dégâts physiques et psychiques que peuvent engendrer la torture et la répression. »
Propos recueillis par Yvette Adam en 1994 pour le FLAMBEAU (journal des FLAM).