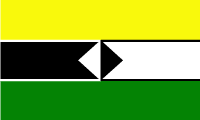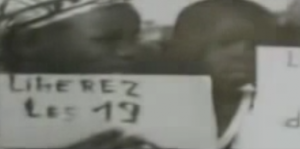
Aux débuts de l’indépendance, plus des trois quarts de la fonction publique mauritanienne sont tenus par des noirs; plus de 80 % dans l’enseignement et les PTT. Ils avaient accepté l’école, parlaient et écrivaient le français. De nombreux Dahoméens qui étaient les commis de l’administration de Dakar à Brazzaville – surnommés les porte-plumes de l’Afrique -sont d’abord expulsés pour laisser place aux nationaux.
Puis se pose le problème de l’équilibre entre Noirs et Maures. Rien de religieux dans cette rivalité: les Toucouleurs sont encore plus pieux musulmans que les Maures chez lesquels quelques pratiques berbères ont subsisté.
Elle est ancienne comme le monde, la rivalité entre agriculteurs sédentaires et pasteurs nomades. Elle est économique dans la mesure où en 1965, l’essentiel des revenus en Mauritanie provient d’abord et de loin des salaires de la fonction publique. (Plus tard, l’enjeu sera aussi la production agricole en zone irrigable au nord du fleuve.) Un revenu de fonctionnaire fait vivre une famille, un clan.
Pour dégager les postes en faveur des Maures, le gouvernement décide d’augmenter la place de l’arabe dans l’enseignement, à l’oral et à l’écrit, avant de l’exiger pour l’accès à la fonction publique. Les Noirs contre-attaquent en déclarant qu’ils sont majoritaires en Mauritanie, si on ajoute aux Noirs libres du fleuve les Noirs captifs et tributaires des campements et palmeraies; ils exigent donc un vice président noir et la moitié des ministres.
Au-delà du changement de la constitution, c’est la mise en cause de l’équilibre social. Trois fois le gouvernement mauritanien a solennellement proclamé l’abolition de l’esclavage. C’est dire s’il est vivant. Mais pas comme on se l’imagine en France et pas comme le mot français invite à se le figurer, avec chaînes et marchés (quoique lhama, la » viande »…). « Serviteurs traditionnels», disait la terminologie du temps des colonies. C’est aussi une sorte de sécurité sociale primitive .Un esclave qui travaille en ville, à la construction de Nouakchott, s’il a payé le tribut à son maître, peut retourner chez lui dès la fin du chantier, il sera accueilli et nourri. Le montant du tribut dépend essentiellement des rapports sociaux. Il peut aller de 90 % pour un manœuvre à presque rien si l’esclave est quelqu’un de haut placé. J’ai vu un fils de captif, directeur de cabinet, payer son tribut au Maure qui venait lui rappeler sa généalogie en lui offrant -non un paquet -, une cigarette ! Le directeur de cabinet, s’il perd sa situation, pourra rentrer au campement…
Les troubles vont commencer au lycée de Rosso au bord du fleuve, lieu de passage avec le Sénégal où les Noirs sont très largement majoritaires, ainsi qu’au lycée de Nouakchott. Grèves, bagarres sanglantes entre élèves. Je suis prévenu par le colonel Troncoso, ancien d’Ecouvillon et numéro deux de l’ambassade d’Espagne, que les Maures font descendre sur la capitale des camions de Harratines et tributaires de l’Adrar, cœur de la Mauritanie maure, « pour donner une leçon aux Noirs ». Pour que cette leçon soit plus spectaculaire encore, ils enverront leurs esclaves contre les Noirs libres très nombreux qui habitent Nouakchott, pour bien montrer:
1) qu’ils ne touchent pas eux-mêmes aux Noirs;
2) que le calcul de l’élite noire additionnant populations du fleuve et tributaires est tout à fait stupide, puisque la leçon est donnée aux premiers par les seconds. Brusquement tout le gouvernement -oui, tout le gouvernement et le président de la République -quittent Nouakchott pour une visite aussi officielle qu’imprévue au Mali. C’est à la fois le signal et l’alibi. La voie est libre pour le pogrom.
Très tôt le matin, des groupes de Harratines, vingt ou trente, encerclent les Noirs libres qui se rendent aux bureaux et les assaillent à coups de bâton et de pierres. Un esclave n’a pas le droit de toucher une arme à feu. La tuerie est donc lente. Quand la victime à terre ne bouge plus, les Harratines passent au suivant.
Un ambassadeur n’est là que pour observer et rendre compte de ses observations ? Je ne vais pas regarder tuer les gens sous mes fenêtres et à ma porte, les bras croisés, sans intervenir. Je ne demande pas d’instructions à Paris, je réunis à l’ambassade les Français disponibles, civils et militaires. Nous avons quatorze véhicules : deux Français et un drapeau par véhicule. Nous sillonnons Nouakchott.
A chaque attroupement, nous descendons, drapeau en tête, écar tons les Harratines, ramassons le blessé et le ramenons à l’ambassade. Vers 10heures, c’est le drame. Un fonction naire noir, craignant pour son fils, va le chercher en classe, armé d’un pistolet. Est-ce l’exaltation, la crainte, la volonté de vengeance ? Il tue d’une balle le premier Maure qu’il rencontre.
Dès lors, tout s’exaspère et s’accélère. Il existe une mystérieuse frontière entre tuer à coups de bâton et avec une arme à feu. «On a tiré» est un signal de guerre. Un Français vient me prévenir qu’au ksar la garde nomade (tous bidanes) s’emploie à maintenir les Noirs pendant que d’autres Noirs les assomment et les égorgent. Je rappelle que plus un seul membre du gouvernement n’est présent.
A la Présidence, un jeune Maure, directeur adjoint de cabinet, est censé assurer la permanence. Au téléphone depuis le matin avec le chef d’état-major de l’armée, qui est un ami, nous avons mis au point les modalités de l’intervention militaire qui arrêtera le massacre. Encore faut-il qu’un Mauritanien en donne l’ordre. Je prends ma voiture -sans chauffeur -pour rejoindre la Présidence,

Dans le bureau du jeune directeur adjoint, je sacrifie aux rites de la politesse, parlant d’abord d’autre chose. Mais chaque seconde perdue se compte en morts. Écoutez. Une ville où l’on tue fait un bruit qui ne s’oublie jamais. Une sorte de rumeur rauque, de voix enrouée lointaine, d’appel du cœur et des entrailles qui ne parvient pas à passer la gorge, trouée parfois de l’écho d’une détonation. Écoutez. Une ville où on tue, émet, très bas -je n’oublierai pas -une plainte d’animal qui meurt au pied d’un mur, au fond d’un fossé.
Je dis au jeune homme: « Je vais rentrer à l’ambassade. Le correspondant de l’AFP m’y attend pour envoyer la dépêche où il racontera au monde entier comment, dans un pays arabe indépendant, l’ambassadeur de France est obligé d’aller lui-même sauver les habitants du massacre. Ou bien -simple. hypothèse de ma part -vous prenez ce téléphone, vous faites 37-28, et vous dites un seul mot au chef d’état-major qui attend : intervenez. Plus de dépêche, puisque les événements seront déjà du passé.»
Il prend le téléphone: «Colonel, intervenez.» De retour vers l’ambassade, je suis bloqué un moment sur la route par un attroupement. Un petit vieillard s’affaire à côté de ma voiture. Je me penche pour regarder. Avec des vieux papiers et quelques bouts de bois, il a allumé un feu sous le moteur. Marche arrière doucement, très doucement. Tout accident serait utilisé comme une provocation.
Le lendemain, le Président et le gouvernement reviennent, se lavant les mains de la «punition» qui a tourné au massacre. A l’ambassade plus d’une centaine de Noirs blessés se sont réfugiés. Le chiffre des morts officiellement reconnu est de six. En fait, il est beaucoup plus élevé, il faut sans doute ajouter un zéro.
Un longue période de crise vient de s’ouvrir. «Construisons ensemble la patrie mauritanienne», avait dit Moktar… «Nous serons la Suisse de l’Afrique.» Chaque jour connaîtra son lot de violences, vengeances et règlements de comptes. Le gouvernement, après s’être fabriqué un alibi, cherche maintenant un bouc émissaire. Mon collègue et ami l’ambassadeur d’Espagne va bien involontairement le lui fournir.
Dans ses affaires il a conservé – souvenir de la légion Azul et du front russe – un pistolet soviétique. Son cuisinier guinéen, qui a peur de rentrer chez lui, dérobe le pistolet de l’ambassadeur. Il est arrêté par une patrouille de l’armée et fouillé. Dans le désert tout est signe. Un pistolet soviétique sur un Noir! L’URSS aurait- elle décidé de changer de politique en Afrique et jouer les Noirs contre les Arabes? Une décision est prise au plus haut niveau: toutes les ambassades seront bloquées et surveillées militairement. Interdiction à quiconque d’y entrer et d’en sortir, sauf à l’ambassadeur lui-même, Escouades de l’armée à la porte. Ainsi seront empêchés les éventuels trafics d’armes sans paraître viser directement l’URSS. Ainsi les étrangers seront suspects des massacres. D’une pierre deux coups.

Ce ne sont pas les 55 jours de Pékin, mais les 11 jours de Nouakchott. L’ambassade abrite plus de cent personnes, dont blessés et enfants, à soigner et à nourrir. Mon collègue russe m’appelle pour signaler solennellement au doyen que ce siège des ambassades est tout à fait contraire aux privilèges diplomatiques reconnus par la convention de Vienne. Certes. A lui et aux autres ambassadeurs, j’explique que désormais c’est une affaire de sang-froid. Le gouvernement se veut odieux. Attendons qu’il soit ridicule.
Je dois prendre très vite deux décisions très difficiles. Le porte-parole de la colonie française, qui loge en ville, me demande de recevoir à l’ambassade tous les Français qui se sentent menacés. J’ai bien donné asile aux Noirs! Je dis non. Je dis non parce que si les Français se réfugient à l’ambassade, leur geste sera compris comme un aveu de culpabilité. Telle est la loi de ce monde. Celui qui fuit devient un gibier que le chasseur peut et doit tirer. Non. Je demande à tous les Français de garder le contact les uns avec les autres en s’organisant discrètement, autour de responsables désignés par immeuble et par quartier. Qu’ils s’assurent d’un téléphone. Si l’un d’eux est le moins du monde menacé, une permanence fonctionne jour et nuit à l’ambassade. Je viendrai moi-même le chercher. Au cas où le téléphone serait coupé, un système de message est prévu.
Oui, c’est une affaire de sang-froid. Ne nous comportons pas en coupable, nous serions jugés coupables.
Les rapports que j’ai envoyé à Paris n’ont pas dramatisé – plutôt minimisé – les faits. Mon collègue du Sénégal et d’autres sources n’ont pas eu la même réserve. Des voyageurs et des Noirs qui ont pu passer la frontière racontent les horreurs du pogrom. Deux compagnies de parachutistes sont mises en alerte rouge, prêtes à sauter sur Nouakchott pour dégager l’ambassade. Je ne sais plus si c’est par télégramme, téléphone ou les deux, mais je fais savoir à Paris que le seul à pouvoir juger si une intervention militaire est nécessaire pour me sauver, c’est moi. Et je prends l’entière responsabilité de refuser. Ne pas penser à ce qui se passera ensuite, après, quand les parachutistes seront repartis. Pendant onze jours j’ai très peu dormi.
L’ambassadeur d’Espagne, involontairement à l’origine de ces événements, va me fournir l’occasion d’en sortir. Comme tout franquiste un peu démagogue à l’égard du monde arabe (il faudra attendre le roi Juan Carlos pour que l’Espagne reconnaisse Israël), il a invité le sous-officier qui gardait son ambassade à se mettre à l’ombre, à la maison. Erreur. Un soir, l’ambassadeur m’appelle. Il éructe tellement de rage au téléphone, il parle un sabir si indigné que je mets un moment à reconstituer l’aventure. Rentrant d’une course à l’extérieur, il a trouvé le sous-officier mauritanien dans son lit. Fumant l’un de ses cigares. C’est le pyjama qui l’indignait le plus (et le fait qu’il s’agissait d’un simple sous-officier). Je lui dis: «Cher Pédro, ne t’inquiète pas, merci»? Et je fonce chez le Président de la République. Sérieux comme un doyen de corps diplomatique, je raconte à Moktar le coup du pyjama. Voilà ce qui arrive quand on déploie la soldatesque au mépris des conventions de Vienne. Bien sûr, je dois faire une protestation officielle et rendre compte dans nos capitales. Les autorités mauritaniennes ne sont pas odieuses, non, ne rêvez plus, elles vont seulement être ridicules.
Nous ne sommes dupes ni l’un ni l’autre. C’est un prétexte. Mais je crois que Moktar est assez heureux de saisir lui aussi l’occasion, si burlesque soit-elle, d’en finir avec une épreuve de force xénophobe qui ne pouvait, si elle durait, que se terminer par un nouveau drame. Il prend son téléphone et fait lever toutes les mesures de contrôle des ambassades. Nos parachutistes n’ont pas eu à intervenir. La crise mauritanienne n’est pas finie pour autant.
A Zouérate où les cadres français de la Miferma vivent complétement à part dans leur concession, j’ai prévenu les dirigeants qu’ils allaient à l’explosion. Si les ingénieurs ne regardent pas à la dépense pour envoyer un avion chercher une pièce manquante, ils refusent de payer un bon officier d’AI connaissant le caïdat qui recevrait, écouterait, arrangerait. Les juristes de la société, pour éviter que ne se créent des servitudes, font évacuer tous les petits commerces établis à l’intérieur de la concession, Personne à Miferma n’a pensé que ces petits commerces sont tenus par des Noirs harratines qui sont en fait des tributaires appartenant à un chef maure, et que ce chef maure est le patron du syndicat mauritanien de la Miferma!
Invraisemblable et incompréhensible pour un ingénieur français. Mais la vengeance du chef maure sera rapide: on comptera plusieurs blessés à coups de pelle. En 1968, il y aura plus grave et l’armée mauritanienne devra tirer, faisant plusieurs tués. La naissance d’un Etat n’est pas très différente de celle d’un enfant. Beaucoup de douleurs, de cris, de sang et d’humeurs.
Extrait des “Mémoires de 7 vies
Tome 2, Croire et Oser”
De Jean-François Deniau de l’Académie française
Ambassadeur de France en Mauritanie et doyen du Corps diplomatique de 1963 à 1966
Editions PLON 1974