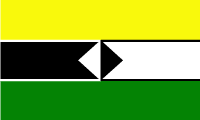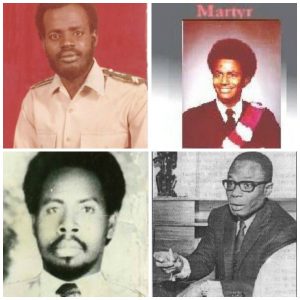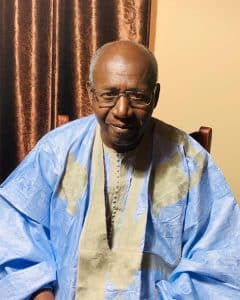« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. » Nelson Mandela
Prenant prétexte de la participation des Forces de Libération Africaine de Mauritanie (FLAM) à la création, le 12 novembre 2022, de la plateforme « Engagés pour une Mauritanie Unie » (EMU) qui a pour objectif d’unir tous les mauritaniens autour de principes de paix, de justice, de vérité, de réconciliation et de développement pérenne, un groupe de militants désengagés a, le 14 novembre 2022, publié sur les réseaux sociaux un document avec l’entête officiel des FLAM sans autorisation, ni légitimité.
En effet, ce petit groupe non représentatif de l’organisation a adressé un courrier en date du 20 septembre 2022 au bureau exécutif national élu au cours du congrès des 26, 27 et 28 août 2022 pour déclarer le gel de toutes leurs cotisations et activités dans l’organisation, pas pour un désaccord sur la ligne politique dégagée par ce congrès, mais sur le refus d’accepter l’élection des personnalités composant le nouveau bureau exécutif national qu’il nomme toujours « bureau provisoire » dans leur communiqué.
Pendant que des pourparlers étaient en cours pour ramener nos camarades (pas plus de sept (7) à la raison, d’autant plus qu’ils avaient participé au congrès et avaient été mis en minorité, la création de la plateforme de concertation EMU a été l’occasion pour eux de se faire une publicité mensongère, arguant du fait que la base n’avait pas été informée, alors qu’après enquête, il s’est avéré que certains noms avaient encore une fois été rajoutés sur la liste des signataires sans l’accord de ces derniers, comme pour leur premier courrier du 20 septembre dernier.
Ils ont profité de l’engouement médiatique suscité par cette rencontre pour usurper des documents officiels de l’organisation et faire une déclaration dans le but de nuire aux personnalités élues lors du dernier congrès des FLAM alors que leur action n’a porté préjudice qu’à l’image et à la crédibilité des FLAM et au combat que nous menons depuis des années pour permettre aux mauritaniens de réellement et sincèrement se réconcilier autour des valeurs universelles d’égalité, de fraternité et de justice.
Les quelques marginaux ayant participé à cette nouvelle déclaration de rejet des décisions prises par le bureau national des FLAM après celle du rejet des instances élues, ont réaffirmé leur volonté de ne pas reconnaître les décisions prises par le congrès des FLAM et de rejeter toute idée de fonctionnement démocratique au sein de notre institution.
Après avoir reçu de nouveau le soutien massif des militants, de nos différents responsables de sections à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que de nos amis, alliés et soutiens politiques, les FLAM, membres de la coalition vivre ensemble ont décidé de confirmer leur participation à cette plateforme de concertation et de dialogue ouverte à tous les mauritaniens désireux de s’engager de manière sincère pour contribuer à donner un avenir meilleur à la Mauritanie.
En effet, cet engagement n’est que la poursuite de la volonté des FLAM de continuer à tendre la main et de dialoguer avec toute force politique qui reconnaît les mêmes droits à tous les mauritaniens et souhaite l’effectivité d’une Mauritanie multiculturelle, démocratique et unie.
C’est dans ce contexte que nous appelons donc toutes les mauritaniennes et tous les mauritaniens à se saisir de cette opportunité unique que nous offre l’histoire de notre pays afin d’apporter le vrai changement et bâtir ensemble une Nation unie et prospère.
Le département de la communication
Le 19 novembre 2022