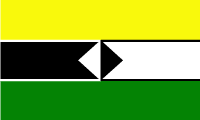Durant des siècles, appuyé par un racisme assumé et légitimé, l’esclavage a perduré au Maroc. Entre volontés impériales, religion et logique économique, retour sur un douloureux passé.
Nous sommes au milieu du XIXe siècle. Ahmed Khaled Naciri, savant et historien slaoui, publie des diatribes antiesclavagistes. S’il reconnaît la validité religieuse de l’esclavage, il condamne sa pratique et sa légitimation par les différences raciales. À cette époque en effet, des milliers de noirs — entre 50 000 et 300 000 selon les sources — connaissaient toujours les affres de la servitude. Même si l’islam incite à libérer les esclaves, cette pratique était largement répandue dans le monde musulman, et l’empire chérifien ne dérogeait pas à cette règle. C’est ainsi que, depuis l’installation de la dynastie des Almovarides au XIe siècle, des centaines de milliers de noirs — plus de trois millions selon d’autres sources — sont raflés et acheminés à travers le désert jusqu’aux marchés de Sijilmassa, Marrakech, Fès ou Rabat.
Des logiques esclavagistes
Le pouvoir politique ainsi que les fouqaha étaient des acteurs principaux de cette pratique. Une complicité qui arrangeait les intérêts de tout le monde. Selon l’historien Roger Botte, le sultan Moulay Abderrahman prélevait une taxe d’un esclave sur vingt aux marchands. Le souverain est allé jusqu’à statuer personnellement sur les vices rédhibitoires, comme la lèpre ou la déficience mentale, qui invalident une vente d’esclave. Mais contrairement aux idées reçues, l’esclavage au Maroc « n’a jamais été absolument nécessaire à l’économie », comme nous l’explique l’historien Mbarek Aït Add. L’esclavage répondait à différentes fonctions au sein de la société marocaine. Dans son ouvrage Black Morocco, l’universitaire Chouki El Hamel remarque en effet que la plupart des esclaves travaillaient surtout comme domestiques dans les foyers. D’autres exemples nous éclairent sur les tâches assignées à ces hommes et femmes tombés en servitude. On peut noter alors que des esclaves soudanais ont bâti une partie des murailles de la ville d’Essaouira, et qu’au XVIe siècle, ce sont des esclaves qui travaillaient dans les raffineries de sucre installées dans le Souss et la région de Chichaoua, permettant le troc de cette denrée contre d’autres biens précieux, comme le marbre d’Italie. Enfin, quelques esclaves étaient « exportés » vers les Amériques ou les îles Canaries depuis le port d’Essaouira et les côtes sahariennes au XVIIIe siècle. « Il y a bien eu des logiques esclavagistes au Maroc », conclut le chercheur Mustapha Naïmi. Des logiques qui mêlent racisme et conquêtes militaires et se trouvent souvent en butte au fait religieux.
Racisme et religion
« Les expéditions militaires en Afrique de l’Ouest ont bien sûr donné un coup de fouet à l’esclavagisme », remarque Naïmi. El Hamel rapporte les propos d’un chroniqueur marocain qui raconte que l’expédition envoyée par le sultan Ahmed Al Mansour en Afrique subsaharienne, en 1598, est revenue au Maroc avec dix-mille captifs hommes et autant de femmes. Ces actions militaires menées contre l’empire songhaï, en partie islamisé, ont choqué de nombreux ouléma qui réprouvaient l’usage de la violence contre des musulmans, pratiquant le rite malékite comme eux qui plus est. La mise aux fers de Ahmed Baba, théologien très réputé de Tombouctou, lors de cette opération, a indigné les ouléma marocains. Ahmed Al Mansour s’est défendu contre ces critiques en invoquant l’intérêt pour le monde musulman d’une unité pour légitimer son action. Moins d’un siècle plus tard, le sultan alaouite Moulay Ismaïl aura lui aussi recours à des arguments religieux pour justifier la création de son armée noire, la fameuse garde des Abid Al Boukhari, qui comptera jusqu’à 60 000 soldats selon plusieurs sources. Le sultan comptait réduire à l’état d’esclaves même les Haratine, noirs libres et musulmans, pour les intégrer à sa garde. Pour ce faire, il argue qu’il en va de la sécurité de la communauté musulmane, menacée par les chrétiens. Les fqihs proches du pouvoir opinent du chef. Un argumentaire raciste ne tarde pas à être développé pour renforcer la position du sultan. El Hamel cite un alem soussi, soutenant la démarche de Moulay Ismaïl, qui détaille même les tares physiques et mentales des noirs pour légitimer leur asservissement. Le racisme a bien accompagné cette opération décidée par le sultan alaouite, à tel point que le vocabulaire en a porté les marques. Les termes « Abd » et « Aswad » ont longtemps été des synonymes interchangeables, rappelle El Hamel. Et en berbère, les Noirs étaient appelés « atig entisent » ( le prix du sel ), terme qui renvoie à l’idée que tout noir était une marchandise. Devant ce racisme éhonté et profondément aux antipodes de l’égalitarisme islamique, de nombreux ouléma se sont opposés à la réduction en esclavage de musulmans, d’autres ont défendu même les droits des esclaves païens, se basant sur divers traités juridiques malékites. Le fameux cheikh de Tétouan, Ahmed Ben Ajiba, reprochait à ses confrères leur racisme, et Abdessalam Guessous, célèbre alem de son temps, a interpellé avec virulence Moulay Ismaïl sur son projet. Irrité par le comportement de ce alem, le sultan ordonne de l’arrêter et de le tuer par strangulation.
Une abolition tardive
À l’époque moderne, les voix sont devenues plus nombreuses à s’élever contre l’esclavagisme. Le protectorat français n’abolit pas cette pratique, mais prend certaines mesures, comme la circulaire de 1922, pour la limiter. C’est dans cette ambiance que le mouvement national rejoint les religieux pour réclamer l’abolition de l’esclavage. L’historienne Rita Aouad remarque qu’au début du XXe siècle, les ouléma prenaient déjà la défense des concubines esclaves et de leurs enfants dans des affaires d’héritage. En 1934, un groupe indépendantiste publie ses revendications, parmi lesquelles figurent des dispositions abolitionnistes. Deux ans plus tard, rappelle Aouad, les Considérations sur l’esclavage au Maroc de Ahmed Khaled Naciri sont republiées, appuyant la lutte contre le servage. Selon l’historienne, la montée en puissance du mouvement nationaliste contribue ainsi à raréfier l’esclavage dans les milieux urbains éduqués.
Petit à petit, l’esclavage disparaît. Restent les stigmates d’un fait trop peu étudié. Pourtant, « l’histoire récente éclaire en partie le rapport particulier des Marocains à l’esclavage et aux noirs », concède Aouad, qui précisait dans une étude consacrée à ce sujet : « Le fait que l’esclavage n’ait pas été aboli permet d’abord de comprendre l’absence de culpabilité ». Naïmi concède lui aussi que cet épisode de notre histoire ne saurait être écarté d’un revers de main. « Pour comprendre les relations entre les pays d’Afrique du Nord et les pays d’Afrique noire, pour mieux appréhender les migrations Sud-Sud, il nous faut avoir cette histoire en tête », argue-t-il. Une longue histoire qui nous permet de mieux saisir le présent, et comprendre quelques réflexes racistes encore présents au Maroc.
Marrakech : scènes de marché
Dans son livre L’esclavage en terre d’Islam, Malek Chebel explique que Marrakech a été le plus important marché d’esclaves au Maroc. Selon l’historien Mohamed Ennaji, à la fin du XIXe siècle, on vendait, sur ce seul marché, entre 7000 et 8000 esclaves par an. Ces hommes et femmes sont soumis à la vente trois fois par semaine, immédiatement après la prière du fajr. Parfois, quelques-uns sont exposés aux marchés réservés aux animaux. Des prières aux saints de la ville et la Fatiha sont prononcées avant la vente. L’acheteur vérifie les dents, s’enquiert de l’état de santé de son « acquisition » et, dans le cas des jeunes femmes, on pratique, selon l’historien Roger Botte, l’istibra’, un rapide examen pour vérifier sa virginité. En effet, si quelques vendeurs assurent la vente d’esclaves de « qualité », parfois initiés à la langue arabe, à une clientèle triée sur le volet, d’autres commerçants moins honnêtes n’hésitent pas à bander ou maquiller les esclaves avant la vente pour faire ressortir leurs muscles et cacher leurs cicatrices… Le marché de Marrakech, qui côtoyait la place Jamaâ El Fna, a été fermé par les autorités coloniales en 1912.
Gnaoua : de la servitude à la pop culture
Le monde des Gnaoua est toujours entouré de mystères. L’étymologie du nom même reste incertaine, venant possiblement de « Guinée » ou « Ghana » ou encore de « guinawn », terme berbère mauritanien pour désigner des habitants du Sénégal. Une certitude cependant, l’histoire des Gnaoua est liée à celle de l’esclavage. Comme le prouve leur vocabulaire, ils ont des origines variées : soninké, bambara, haoussa… Plusieurs anthropologues relient d’ailleurs leur art à celui des griots mandingues. Et si leur lila, ou derbeba, sont des cérémonies religieuses, de transe, elles sont aussi des moments où la douloureuse histoire des esclaves du Maroc est retranscrite. Aux côtés des invocations, les paroles laissent d’ailleurs une place de choix aux thématiques de l’asservissement et du déplacement forcé, du souvenir d’une terre lointaine dont les Gnaoua ont été arrachés. Leur pratique religieuse est aussi marquée par des restes de rituels africains préislamiques, aujourd’hui diluées dans l’islam soufi marocain. Longtemps méprisée, la culture musicale gnaouie est, selon de nombreux spécialistes, similaire en plusieurs points aux cultures afro-américaines : elle a créé une identité, suscité une solidarité. Avant de devenir plus mainstream. Du père du maâlem Boubker Gania, esclave kidnappé et amené au Maroc il y a un siècle environ, à Abderrahman Paco de Nass El Ghiwane, qui s’inspira de cette musique, sans oublier le festival d’Essaouira, la musique gnaouie a une longue histoire.
Source: telquel.ma