
Le jeudi 26 août 1988 à 15h 05 mn est décédé le Maréchal de Logis chef de la Gendarmerie Alasan Umar Bah dans la grande salle de la prison mouroir de Wâlata où étaient parqués des FulBe et des Wolof de la mouvance nationaliste qui lutte contre l’hégémonie et le racisme des Arabes en Mauritanie.
«Laa i laaha illallaah, AlasanUmar yehiii» («Laa ilaaha illallaah , Alasan Umar est parti») a crié une voix. Tout le monde s’est précipité, certains en récitant des versets du Qoran, près du corps qui venait de rendre son dernier souffle après avoir protesté de sa dernière plainte.
Depuis que nous étions arrivés à Wâlata le 11 décembre 1987, la plupart avait remarqué la discrétion et le stoïcisme de Alasan Umar. Il était arrivé dans cette prison avec un traumatisme physique encore visible causé par les tortures qu’il avait subies. Le mal s’était installé dans son corps depuis Nouakchott et Jreïda où ses bourreaux lui avaient réglé son compte. «Il est extraordinaire ce bonhomme ; tu ne l’entends jamais se plaindre, malgré les souffrances» me disait un jour Sammba Caam. Quelques heures avant sa mort, on l’entendit se plaindre. «Depuis ce matin Alasan se plaint, ce n’est pas habituel chez lui» m’avait dit Paate Bah.
Ses plaintes ne surprenaient guère. La faim faisait réellement ses effets sur nous tous sauf évidemment l’ex-commissaire de police Lih Mammadu, son cousin feu Lih Muusa et l’ex-capitaine Joop Jibril. Au mois de juillet j’avais noté 41 cas de béribéri, sans parler d’autres carences alimentaires qui donnaient à certains d’entre nous l’apparence de squelettes.
Il est impressionnant, d’entendre un adulte gémir, pleurer à chaudes larmes parce qu’il ne supporte plus la souffrance causée par la faim. «woy heegam neenam, mbede heyDi». Pendant ces moments nocturnes, tout le monde fait semblant de dormir. La première fois que j’entendis ce genre de lamentations c’était à la prison civile de Nouakchott en décembre 1986. Un jeune Camerounais qui pleurait comme un enfant dans le pavillon des droits communs qui nous était interdit comme le nôtre leur était interdit. Le lendemain matin, mon voisin Abuubakri Kaaliidu Bah prit le risque et alla lui remettre du lait et des arachides. Le brigadier dont je ne retiens pas le nom, désapprouva le geste en disant que ce Camerounais ne méritait pas une telle générosité parce qu’il était chrétien. Il décéda deux jours après. Cette affaire suscita encore une fois un débat sur l’islam, les Arabes et l’humanisme.
Pour en revenir à Alasan Umar, je racontais à Paate la promesse que j’avais faite à celui-ci dans la semaine de notre transfert à Wâlata et qu’il me rappelait souvent. En décembre 1977, lorsque je préparais mon mémoire de maîtrise en Histoire intitulé Les relations entre les Haal pulareeve et les Brakna (1850-1903), j’avais interviewé à Bogge dow son grand-père maternel sur les relations entre les HalayBe et leurs voisins Bîdân et Hrâtîn immédiats, particulièrement leurs éternels ennemis, les Awlâd Seyyid. J’avais gardé la cassette audio dans ma bibliothèque, à la maison. J’avais promis qu’une fois hors de prison, je lui donnerai une copie.
Dans la salle où les prisonniers politiques étaient parqués comme du bétail (nos geôliers nous appelaient hayawân, parce qu’ils avaient décrété dès notre embarquement dans les camions remorques à bétail que nous étions des animaux, pas des être humains), la place de Alasan Umar se trouvait non loin de la porte qui donnait accès aux latrines. Il me rappelait bien souvent ma promesse lorsque que je passais devant lui. Du 11 décembre 1987 au 26 août 1988, son corps était resté la presque totalité de ce temps qu’il fit à Wâlata, le plus souvent allongé qu’en position debout. Les rares moments où il sortit de la salle, c’était au mois de février. Il avait même tenté de partager avec la quasi-totalité des prisonniers les corvées d’eau qui nous avait été imposées par l’administration de la prison, mais cela ne dura pas longtemps. Physiquement, il était devenu trop faible.
Ma promesse avait fini par établir entre nous une relation bien particulière que je ne saurai définir.
Pendant que les camarades défilaient devant son corps, je suis resté allongé pendant quelques minutes à ma place située à l’autre bout de la salle. Il fallait que je me prépare psychologiquement à regarder Alasan Umar Bah mort, que mon corps vivant assimile le sien qui est désormais sans vie. A mon tour, je me suis présenté devant LUI. Je me suis recueilli pendant quelques minutes en regardant longuement et profondément ce corps allongé. En ce moment précis, j’étais incapable de dire ce que je ressentais réellement. C’est bien plus tard, devant le corps de Tafsiiru Jiggo que je trouverai la réponse. Mais face à ce corps désormais sans vie, je sais tout simplement que j’étais frustré. Je n’aurai donc plus jamais l’occasion de lui remettre une copie de la cassette pour écouter parler son défunt grand-père.
Alors j’ai murmuré pour que les autres ne m’entendent pas : «Je n’oublierai pas la cassette. Je l’enterrerai un jour dans ta tombe lorsque nous ramènerons tes restes au pays, au Fuuta Tooro», puis, je rejoignis ma place, plongé dans mes réflexions. Vers 14h 45 mn, le commandement du fort envoya des gardes pour prendre le corps et l’enterrer. Où ? Nous ne savons pas. La violence et les humiliations que les Noirs, particulièrement les FulBe subissaient depuis septembre 1986 avaient contribué à nourrir de la haine entre nous et les Bîdân et leurs Hrâtîn qui faisaient preuve d’une brutalité bestiale insoupçonnable. Dans cet environnement nourri de haine, de souffrances, d’humiliations, tout ce qui émanait du Bîdân et du Hrâtîn était symbole de négation, d’impureté.
Dans cet état d’esprit, comment pouvions-nous concevoir leur laisser le corps de notre camarade ?. D’autant que nous les soupçonnions de vouloir s’en débarrasser dans une fosse peu profonde et sans aucune cérémonie rituelle traditionnelle. Aussitôt partis, les fauves viendraient déterrer le corps. C’est Umar Gey qui exprima brutalement tout haut ce que la plupart d’entre nous étaient en train de penser. L’ex-sergent Jibi Duwaa Kamara ne s’empêcha pas d’exprimer ses ressentiments avec ses injures bien salées, spontanées dont lui seul avait le secret. Une injure sortie de la bouche pleine de salives de Jibi Duwaa Kamara, c’était différent : «hay Capaato Bii (. ) memataa Doo maayDo amen» (traduction littérale, «aucun Bîdân, fils de (.) ne touchera ici notre mort»).
Spontanément, un groupe fit alors un barrage humain devant la porte pour empêcher les gardes d’entrer. Un autre alla encercler le corps de Alasan Umar, toujours allongé à la même place. Spontanément, et sans en mesurer les conséquences, nous avions décidé, ensemble, que jamais le corps de notre camarade ne sera souillé par nos tortionnaires. Certes, nos corps à nous étaient souillés par les tortures et autres sortes d’humiliations. Mais Alasan Umar mort, son corps avait retrouvé toute sa pureté de naissance, car il fallait qu’il rejoigne le monde de nos Ancêtres avec un corps et une âme purifiée. Sinon, il n’y serait jamais accueilli.
Nous décidâmes par conviction que c’est nous-mêmes qui allions l’enterrer. Comprenant que face à cette nouvelle situation, la plupart des prisonniers politiques étaient décidés à tout pour sauvegarder l’honneur du corps, la direction carcérale accepta, sans trop hésiter, notre proposition. Quelques éléments furent désignés pour aller creuser la tombe au cimetière. Je me suis porté volontaire avec d’autres pour former une équipe de 17 fossoyeurs conduite par Abdullaay Saar et Umar Gey.
En file indienne, nous nous dirigeâmes en silence vers le cimetière situé à environ six cents mètres au sud-est du fort, escortés par des gardes toujours sur le qui-vive, toujours prêts à tirer sur nous avec leurs fusils mitrailleurs. Seuls les bruits des «chaînes du Colonel Brahim Ould Alioune Ndiaye» rompaient ce silence. Les chaînes qui nous entravèrent les pieds du 2 janvier au 31 octobre 1988 étaient ainsi dénommées parce que ce Colonel chef d’état major de la Garde nationale avait eut l’idée de commander des chaînes exclusivement pour nous faire subir les pires souffrances.
Même enchaînés et menottes aux poignets, les gardes redoutaient encore nos militaires, car ils avaient vu la plupart d’entre eux à l’?uvre pendant la guerre du Sahara occidental. Certains des officiers et sous-officiers les avaient même commandés, d’où les relations ambiguës qu’ils continuèrent à entretenir avec leurs anciens chefs hier redoutés, aujourd’hui leurs prisonniers. L’attitude des gardes bîdân était unanime : haine, mépris, agressivité. Avec eux, nous savions comment nous comporter. Un seul fera exception, le lieutenant Mohamed Lemine.
Chez les Hrâtîn, les relations avec la plupart étaient plutôt complexes et irrationnelles, car avec eux, celles-ci allaient d’une extrême à l’autre. Ils étaient très versatiles. Un garde hrâtîn pouvait glisser à un prisonnier politique, nuitamment, quelques morceaux de sucre, du tabac, quelques grains d’arachides, et le torturer quelques jours après sans que cela ne semble perturber sa conscience. Cependant, quelques rares comprenaient l’enjeu politique et pensaient à l’avenir. J’avais remarqué deux parmi eux qui se débrouillaient toujours pour ne jamais participer aux séances de tortures. Je rencontrerai l’un d’eux à ma libération, à Vogge. En tout cas l’expérience avait fini par nous enseigner qu’il fallait se méfier d’eux.
Bah Mammadu Siidi, qui est infirmier d’Etat, accompagna Cheikh (l’infirmier hrâtîn qui indiquait, à l’occasion des séances de tortures les parties sensibles du corps où il fallait frapper pour faire mal) pour constater le décès. Pendant que nous creusions la tombe, la cérémonie pour la toilette mortuaire était dirigée par Tafsiiru Jiggo qui faisait fonction d’Imâm du groupe des prisonniers politiques et par Abuubakiri Jallo son adjoint.
Dans la salle, le lendemain après l’enterrement, je restais impressionné, je dirai même choqué par l’insouciance apparente ou réelle affichée avec les rires, les farces de certains comme si nous n’étions pas en deuil. Cette insouciance affichée avait toujours intrigué nos gêoliers, depuis notre arrivée à Wâlata. Elle effrayait même certains qui nous prenaient pour des êtres anormaux. Comment vivre cette situation carcérale et se comporter comme si nous étions dans une situation normale.
En nous regroupant tous ensemble, le régime n’avait pas compris combien il nous rendait un grand service. Une analyse sur laquelle je reviendrai aussi. J’avais souhaité donc que l’on affichât une atmosphère de deuil dans la salle, mais l’ex-adjudant Woon Sammba Yero, l’ex-adjudant-chef Pape Gey et le maréchal des logis Mammadu Habii Bah issus tous du corps de la gendarmerie étaient en train de jouer au cokki. Ils criaient, chahutaient, injuriaient comme ils savaient si bien le faire eux aussi. Comme si nous n’étions pas en deuil. Je fis la remarque à Abdullay Bari qui tenta de rappeler à certains plus de retenue pour la circonstance : «njiiDDaa ko yimBe ngoya. Maayde ko maayde tan. So ari ari. Hay gooto waawaa heen» rétorqua le plus naturellement Woon Sammba. Puis ils continuèrent leur jeu. Et dire que c’est Woon Sammba yero qui était pressenti par la plupart comme celui qui allait mourir le premier. Il était très atteint par le béribéri. Malgré tout, il avait gardé le moral très haut.
Nous ne voulions plus en parler publiquement depuis quelque temps, mais la mort s’était annoncée paradoxalement par plusieurs signes métaphysiques, à travers les rêves. Une analyse sociologique qui demandera encore quelques pages d’écriture. Nous semblions presque tous préparés psychologiquement à mourir. Nous attendions sa venue comme une chose normale dans le contexte où nous vivions, tout en espérant au fond de nous-mêmes que Alasan Umar Bah soit le dernier. Une semaine après Alasan Umar, le vendredi 2 septembre, c’était le tour de Teen Yuusuf Gey de partir. Puis l’ex-lieutenant du génie Abdul Qudduus Bah le mercredi 13, puis Tafsiiru Jiggo le samedi 28 septembre La série blanche allait continuer pendant un mois. A Wâlata, les mois d’août et de septembre 1988 ont été des mois blancs pour notre combat. Nous y reviendrons.
Lors de la crise de 1989, notre maison n’échappa aux pillages organisés par le régime de Wul Taya qui avait fait lâcher des hordes de Hrâtîn transportés dans des camions remorques et débarqués dans des villes comme Nouakchott, Nouadhibou. Des maisons habitées par des Africains furent des cibles de massacres et de pillages qui nous rappelèrent une réalité historique traumatisante et dont nous pensions naïvement que cela relevait désormais du passé. Mais on dit, chassez le naturel, il revient toujours au galop.
Ma bibliothèque n’a pas échappé au pillage. Constituée depuis 1970 elle renfermait près de 600 ouvrages, mémoires, etc, la Bible, le Qoran, la Thora, une collection de journaux dont certains datant de 1966, des dizaines d?enregistrements audio sur mes enquêtes orales sur l’histoire du Waalo Barak, sur l’Emirat du Brakna, sur le Fuuta Tooro. Dans ces cassettes, il y avait des interviews de personnes aujourd’hui disparues et qui ont emporté avec elles notre histoire commune à nous Haal pulreeve, Sooninko, Wolof, Bîdân.
A Aioun el Atrouss où les prisonniers civils furent transférés du 31 octobre au 1er novembre 1988, lorsqu’une personne vint m’annoncer le 11 juillet que notre maison avait été pillée après la déportation de mon épouse le 29 avril vers le Sénégal, ma première réaction fut de demander à la personne qui venait de me donner la nouvelle : «Et ma bibliothèque ?». Une question que la personne a trouvée mal placée. «Au lieu de me demander ce que sont devenus ta maison, tes meubles, etc, tu ne penses qu’à une bibliothèque. La prison t’a rendu un peu anormal ! ».
Je lui répondis avec un ton grave, calme, mais triste «On peut reconstruire une maison, acheter de nouveaux meubles, mais on ne reconstruit pas une bibliothèque. Ce ne sont pas des papiers qui ont disparu, mais une accumulation de capital de savoir. Je ne peux pas faire ressusciter Sammba Naawwel Caam pour avoir une nouvelle interview avec lui». Elle me regarda d’un air incrédule. Elle n’avait pas compris ce que je ressentais depuis que j’avais appris la nouvelle sur ma bibliothèque.
Toujours à Aïoun, le 2 septembre 1988, à l’occasion du 1er anniversaire du décès de Teen Yuusuf Gey, j’ai écrit ce passage dans mes notes de prison : «Anniversaire: premier anniversaire de Teen Youssouf Guèye à Néma (?). Comme pour le cas de Alassan Oumar, on n’en parle pas. Du moins, rares sont ceux qui en parlent. Comme si on avait tout oublié ou on n’ose rien faire pour commémorer ces journées, de peur de la répression. Le régime veut nous imposer une amnésie». En écrivant ces mots, la promesse que j’avais faite à Alasan Umar me revint à l’esprit. Je pensais à la bibliothèque pillée dont la plupart des ouvrages étaient en train d’être vendus dans des boutiques de Bîdân, informations que m’avait données une épouse venue rendre visite à son mari. Je concluais avec amertume que je ne pourrai plus tenir alors ma promesse.
Et pourtant, il faut que je la tienne. Alors j’ai décidé, que le jour de la cérémonie de restitution des corps de nos Martyrs à la patrie et aux familles, cérémonies que nous ferons avec grande solennité, j’enterrerai la copie de ma thèse entière, celle que j’ai utilisée lors de ma soutenance, avec les restes de Alassan Umar. Si je disparaissais de ce monde avant ce jour, ma famille sera chargée de le faire.
Hare koko jokki.
1er septembre 2002
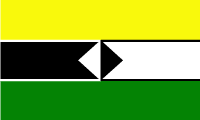









J’ai pas pu retenir mes larmes et je pense que cette histoire sera ancrée éternellement à la fois dans mon esprit et dans mon cœur. «woy heegam neenam, mbede heyDi», et involontairement mes yeux ont laissé couler des larmes. Car chaque personne sait que si un homme se lamente de faim c’est que vraiment il est dans d’humaines conditions. Jamais votre combat ne sera vain.